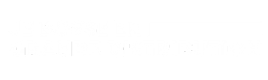Mieux connaître vos clients. Optimisez votre zone de chalandise.
Grâce à des données exclusives modélisées quartier par quartier sur plus de 50 millions de Français, on vous aide à comprendre les consommateurs qui fréquentent votre magasin, comment ils consomment, et comment mieux les toucher.
L'analyse menée par Showhere – avec qui nous proposons des audits géomarketing – met en lumière les disparités départementales en matière de consommation bio régulière (au moins une fois par semaine). La cartographie révèle une France coupée en deux, avec des écarts surprenants qui bousculent certaines idées reçues.
Une France du bio concentrée sur les littoraux et l'Ouest
Les champions incontestés se situent dans le Sud-Est et le Sud-Ouest (scores supérieurs à 40) : Var, Alpes-Maritimes, Vaucluse, Aude, Pyrénées-Orientales affichent les plus forts taux de consommation. On retrouve également des bastions dans l'Ouest, notamment en Bretagne, en Loire-Atlantique et au Pays Basque.
Cette géographie littorale du bio n'est pas un hasard. Elle reflète une convergence de facteurs :
Dans le Sud-Est, le profil sociodémographique joue à plein : populations urbaines éduquées, revenus confortables, forte sensibilité à la santé et au bien-être, influence du mode de vie méditerranéen valorisant les produits frais et locaux. Le tourisme haut de gamme a également contribué à structurer une offre bio premium.
En Bretagne Sud et Pays de la Loire, c'est une autre dynamique : tradition agricole vivace, prise de conscience environnementale forte (qualité de l'eau, marées vertes), et surtout un tissu dense de producteurs bio qui ont su créer des circuits courts performants. La région prouve qu'agriculture intensive et bio peuvent coexister, voire se nourrir mutuellement.
Dans le Sud-Ouest, on observe un mélange des deux logiques : culture alimentaire du terroir qui intègre naturellement le bio, et installation de populations néo-rurales sensibilisées aux enjeux écologiques.

Le paradoxe des territoires en retrait
À l'inverse, le Centre, le Nord-Est (Bourgogne, Lorraine, Grand Est) et surtout l'Île-de-France affichent des scores faibles (inférieurs à 30-32,5), ce qui constitue la vraie surprise de cette étude.
Le cas francilien interroge particulièrement : malgré un pouvoir d'achat élevé et une offre bio abondante, la consommation reste en dessous de la moyenne nationale. Plusieurs hypothèses :
- Rythme de vie urbain favorisant la restauration rapide et les achats d'opportunité
- Arbitrages budgétaires défavorables au bio (coût du logement)
- Offre pléthorique qui dilue la visibilité du bio dans la masse
- Population cosmopolite aux références alimentaires diverses
Dans le Massif central et le Nord-Est, les scores faibles peuvent refléter :
- Des contraintes budgétaires dans des territoires ruraux vieillissants
- Une préférence pour d'autres marqueurs de qualité (AOC, fermier, circuits courts non labellisés)
- Une offre bio moins structurée, moins accessible
- Une culture alimentaire traditionnelle qui ne passe pas nécessairement par le label AB
Implications stratégiques pour les acteurs du marché
Pour les distributeurs
Consolider les bastions : Sud-Est et Ouest sont des marchés matures demandeurs de sophistication
- Élargir les gammes (bio premium, exotique, prêt-à-consommer)
- Développer les formats spécialisés (magasins bio, corners premium)
- Communication axée sur le lifestyle et l'innovation
Adapter l'approche en zone froide : Île-de-France et Centre nécessitent une stratégie différente
- Privilégier l'intégration en GMS plutôt que les magasins spécialisés
- Mettre l'accent sur le rapport qualité-prix et la praticité
- Cibler les produits d'appel (fruits, légumes, œufs) plutôt que les gammes complètes
Le Nord de la Bretagne et la Normandie représentent des zones intermédiaires à fort potentiel : sensibilité existante mais non consolidée, infrastructures agricoles favorables à la conversion.